Organisée les 20 et 21 juin à Champéry, l’édition 2024 des Journées romandes des arts et métiers a été placée sous le thème «Les facteurs de succès des PME».


Avec le formulaire sure la site web de l'usam vous pouvez inscrire jusqu'à huit personnes aux Journées romandes des arts et métiers 2024, organisées les 20 et 21 juin au Palladium de Champéry.
Un petit caveat pour commencer. En rappelant à nos interlocuteurs et participants que ces notes de séance n’ont pas vocation à être exhaustives. La rédaction assume donc une certaine forme de subjectivité dans ces comptes-rendus rédigés en situation.
Bienvenue aux 57es Journées romandes des arts et métiers. Nous nous réunissons pour parler des défis et des facteurs de succès des PME. Nous faisons partie de ce succès. Les arts et métiers ont toujours été au cœur de la croissance et du progrès. Je vous souhaite des journées riches en échanges!

Je vous souhaite moi aussi une cordiale bienvenue aux JRAM. Que faut-il pour avoir du succès? À mes yeux, les facteurs les plus importants sont: d’abord de travailler dur, il faut aussi du courage et, de temps en temps, un peu de chance. Mais surtout, nous avons besoin d’un régime libéral, d’une main d’œuvre suffisante et d’une bonne productivité. J’ai beaucoup voyagé en Suisse ces derniers temps et constaté à quel point nos membres s’engagent pour la formation professionnelle. C’est la réponse des PME à la pénurie de main d’œuvre. Il s’agit là d’un thème prioritaire pour l’usam. La formation continue l’est tout autant. Nous soutenons l’orientation générale du projet du Conseil fédéral sur le bachelor et le master professionnels. Nous luttons contre la surrèglementation et la bureaucratie. C’est le thème clé de l’usam.

Il faut aussi une infrastructure fiable dans trois domaines: l’énergie, le trafic des paiements et les transports. Le 9 juin dernier, le peuple suisse a accepté la loi sur l’énergie. Mais cela ne suffira pas. Pour atteindre les objectifs de la politique climatique, nous aurons besoin de beaucoup plus d’électricité – l’usam participera à la discussion sur le nucléaire. Patrick Dümmler qui est un spécialiste de la question, a commencé à l’usam. Sur le trafic des paiements, les enjeux sont importants et nous travaillons avec Michèle Lisibach.

Quant au domaine des transports, l’usam mènera la campagne en faveur des routes nationales pour lutter contre les embouteillages qui représentent l’équivalent de 3,1 milliards de francs perdus par année. Nous devons gagner cette campagne. Et de manière générale, nous devons garder notre capacité à lancer des référendums. Nous sommes bien organisés dans les régions. Les gens dans les PME ont les pieds sur terre et offrent de bons relais pour nos messages politiques. Mais abordons maintenant le thème des relations avec l’Union européenne. Je me réjouis d’échanger avec vous et, surtout, de parler beaucoup le français!
Merci de m’avoir invitée pour présenter notre point de vue. Nous n’allons pas rendre la discussion plus émotionnelle et je ne vais pas vous submerger de chiffres. Nous sommes des partenaires économiques, tous les jours, dans pratiquement tous les domaines. Quel est notre intérêt à négocier? Je ne rentre pas dans les détails de la négociation. Le mandat nous a été donné de négocier au nom de tous les États membres dont les intérêts sont différents, divergents.
Quand les échanges ont repris fin 2023, nous avons établi un «common understanding», des bases pour commencer de négocier. Il a fallu 18 mois d’échanges pour déterminer ce que l’on veut négocier. C’est notre fil conducteur, le cadre de référence, les points donnés par les négociants dont les intérêts sont pris en compte dans un paquet. Dans toutes les négociations, cela se passe comme ça. Il va falloir trouver des compromis. Et il y a des mots qui reviennent souvent, comme homogénéité, compétitivité, égalité des chances. Dans le mandat suisse, on parle de protection, de maintien de la situation actuelle. Sur les accords institutionnels, on souhaite trouver des solutions pour stabiliser les accords, car la mise en place est parfois difficile.

Parlons de compétitivité. L’UE a l’impression qu’il y a un déséquilibre sur le marché intérieur. L’accès au marché doit être le même pour tous. La libre-circulation est aussi concernée, c’est important que nos citoyens européens résidant en Suisse aient les mêmes chances que les citoyens suisses qui vivent dans l’UE. Certes, le marché du travail suisse est différent. Des mesures de sauvegarde sont prévues.
Nous construisons notre marché commun depuis 70 ans. C’est notre bien le plus précieux sur lequel nous allons nous focaliser. Quand un nouvel État veut faire son entrée, il faut trouver des solutions et des compensations, c’est la politique de cohésion, comme elle existe chez vous entre les cantons et les communes (ndlr, péréquation). Sur le programme Horizon pour la recherche, la confiance est encore en train de se rétablir. Nous ne voulons pas concéder trop tôt sur ce point car l’expérience montre qu’on risque de ne rien obtenir en retour.

D’autres mots reviennent régulièrement, la réciprocité, l’uniformité de l’application
Une précision encore sur la reprise dynamique du droit européen, qui n’est pas synonyme de reprise automatique. Lors de l’arrivée d’une nouvelle législation, un comité se met en place. Actuellement, pour que la Suisse se mette en harmonie, cela peut prendre énormément de temps. La traduction vers la loi suisse devrait évoluer vers davantage de dynamisme.
Pouvez-vous être plus précise sur le déséquilibre qui selon vous avantage la Suisse? On s’est rendu compte que la Suisse profite plus sur son marché intérieur que les entreprises européennes. Une étude publiée en 2019 a montré que le marché intérieur profitait davantage à la Suisse. Mais cela reste difficile à chiffrer. Par rapport à la situation de départ des bilatérales, la Suisse profite des mêmes accords, mais désormais avec 450 millions de consommateurs. Ce déséquilibre s’accroit.
Exemple du type de blocages en Suisse? Notre plateforme «access to market» donne toutes les informations et toutes les barrières. Mais quand on tape «Suisse», on tombe sur les mesures d’accompagnement. Des mesures que nous trouvons, d’un canton à l’autre, d’une commune à l’autre, parfois disproportionnées, voire perçues comme étant à la tête du client. Nous avons aussi beaucoup de PME, qui forcément n’ont pas les moyens de faire face à une telle complexité.
avec
Modération: Pascal Schouwey, journaliste indépendant
Une réaction à cette présentation?
Johanna Gapany: Surprise, non. Une bonne chose de s’entendre, de se parler, de voir les différences, d’avoir des partenaires solides qui disent ce qu’ils pensent. Il faut maintenant trouver un chemin.

Sidney Kamerzin: Je perçois une volonté d’avancer, mais aussi des écueils et des nuages assez importants au niveau institutionnel et syndical. Donc pas beaucoup de surprise, on sait où ça risque de coincer.

François Schaller: Je n’ai pas été étonné, si ce n’est par le ton très diplomatique. L’ambassadeur a pour sa part souvent des propos moins mesurés, et il est assez cassant, aime à rappeler que la Suisse « participe » au marché européen. Il y a là confusion sur les termes. Participer, c’est faire partie. Ce que l’UE veut obtenir de la Suisse, c’est une intégration progressive. Selon elle, cela doit se faire de manière méthodique, puisque chaque étape sera irréversible. D’où les clauses guillotines des bilatérales. Il s’agit, secteur par secteur, d’aller vers l’homogénéisation. Tout ce qui ressemble à des règles du jeu non respectées doit être combattu.

Que souhaite la Suisse?
François Schaller: La Suisse devrait exiger des garanties pour la suite. L’UE dans son mandat de négociation rappelle que son objectif est la reprise automatique, l’alignement dynamique. L’accord de 1972 couvrait l’ensemble de l’économie. Dans le mandat de négociation suisse, il n’en est plus question.
Sidney Kamerzin: Les bilatérales sont la bonne voie à laquelle je souscris. Je comprends les inquiétudes au niveau institutionnel. Il y a aussi un aspect stratégique.
La souveraineté a été un argument lors du vote sur les bilatérales. Pour les mesures d’accompagnement, on va trouver des solutions. La dimension institutionnelle est plus difficile. Par exemple, comment allons-nous expliquer en votation populaire qu’en cas de désaccord sur l’interprétation du droit européen, la décision de la cour de justice européenne sera contraignante ? Ce point sera déterminant dans la négociation.
Johanna Gapany: Ce point fondamental, c’est aussi notre point fort, c’est la démocratie. C’est la population qui décide. On ne va évidemment pas y renoncer. Nous, les PME, nous voulons un accès et discuter avec nos partenaires en Europe. Le rôle du politique, c’est de permettre cela. Pour l’économie, il faut une certaine stabilité. On peut se renforcer et être des partenaires plus solides au niveau de la main d’œuvre nationale, de l’imposition, de la garde des enfants, de l’énergie et de l’alimentation – tout en gardant notre indépendance.

Sidney Kamerzin: Il reste un flou sur les sanctions. Mais même là, on peut trouver des solutions dans la négociation. Mais il faut que nous connaissions les conséquences. Sur l’autonomie, cette contrainte de la justice devrait être détachée. Sur la dernière votation de la libre-circulation, on n’avait pas cette contrainte de la cour européenne. Il faudra être très convaincant pour la faire passer. L’enjeu, c’est où se trouve le pouvoir de décision.
François Schaller: Il ne faut pas entrer dans le jeu, car sinon, le rapport de force sera ce qu’il est déjà. Lisez le common understanding, on est très loin de ce que nous discutons ici. Si on ne veut pas de la Cour européenne de justice, il ne faut pas vouloir entrer sur le marché européen. Le principal accès au marché, c’est la libre-circulation et les directives européennes sur le travail. Il faudra que le Conseil fédéral explique que cela s’arrêtera là. Tout dépend des conditions-cadres. Or celles de la Suisse représentent un véritable obstacle, un vrai échec pour l’UE. On aura en Suisse un droit du travail européen. On sera continuellement dans des relations conflictuelles…
Sidney Kamerzin: Je ne souscris pas à cette vision, mais il faudra clarifier ce point. Selon les documents reçus, en cas de différends, le tribunal arbitral devra le soumettre à la cour européenne et la décision sera bien contraignante. Mon encouragement va aux diplomates suisses, ils devront être très attentifs à ce point. Sur les mesures compensatoires, il faudra les expliquer au moment du débat démocratique, et de manière très concrète.
Johanna Gapany: Je ne suis pas non plus d’accord avec ce tableau très sombre. Je pense qu’il y a quelque chose à faire. Après tout, ce sont nos voisins. Est-ce qu’on ira mieux si on est tout seuls ? A-t-on un intérêt ou non à travailler avec l’UE ? En pleine négociation, soyons constructifs et ouverts, dans cette proximité culturelle. C’est dans l’intérêt de l’économie et de la société suisse. Quand même, c’est notre premier partenaire.
François Schaller: Ce n’est pas du tout ou rien. Par rapport au dispositif actuel datant de 1972, c’est un changement de registre complet. Sur le plan économique avec ses implications sociales et environnementales. Tout nouvel accord sera immédiatement placé sous ce registre.
Le problème dans le débat européen en Suisse, c’est cette tendance à nous concentrer sur les détails, l’arbre qui cache la forêt, au lieu de prendre du recul. J’aimerais montrer la constance, l’intelligence dans le temps de la politique du Conseil fédéral. Commençons par un retour en arrière: j’ai repris les anciens slides d’avant la campagne de 1992. La question qui se posait alors se pose aujourd’hui. Comment ne pas nous découpler de notre propre marché européen?
Après la guerre, on assiste à la création de deux organisations. La première fondée en 1948 est l’Organisation européenne de coopération économique (future OCDE). La seconde en 1949 est le Conseil de l’Europe. Il a fallu quatorze ans à la Suisse pour y participer. Notre idée avec les Anglais était de créer une vaste zone économique de libre-échange pan-européenne. Mais cette démarche a échoué en 1958 et en 1960 se crée une petite zone (AELE ou EFTA). Puis, le Traité de Rome (1957) a ouvert la voie à la communauté économique européenne. En 1972, nous obtenons un accord de libre-échange entre l’AELE et l’Union européenne. Il faut attendre 1984 pour entendre pour la première fois l’expression «espace économique européen».

Cela nous rappelle alors cet ancien idéal de la grande zone de libre-échange. L’idée est alors de joindre les deux organisations, Communauté économique européenne et AELE, pour construire un EEE. Mais la Communauté accélère les choses. L’Acte Unique européen est signé par douze Etats en 1986. L’Espagnol et le Portugal rejoigne la Communauté. Puis Delors change de tactique face à l’AELE. Ce sera notre marché auquel vous pourrez accéder et participer. C’est là que se négocie l’EEE. Des pays comme l’Autriche, la Suède, la Finlande, changent alors de bord et quittent l’AELE.
Le 20 mai 1992, le Conseil fédéral envoie une lettre pour demander l’ouverture de négociations en vue d’une demande d’adhésion de la Suisse à la Communauté économique européenne.
Mais le 6 décembre 1992, le peuple refuse l’EEE. Le Conseil fédéral a le choix entre poursuivre la démarche d’adhésion ou trouver autre chose. En vingt ans, ce projet d’adhésion passe par étapes, du statut d’objectif stratégique à une disparition totale comme variante. En 1992, le Conseil fédéral se demande s’il existe une possibilité de participer uniquement aux domaines qui nous intéressent? C’est du sur-mesure au lieu du package-deal. En 1999, le premier paquet des Bilatérales est accepté, le deuxième en 2004. On développe peu à peu ces accords, jusqu’au jour où l’UE estime que c’est devenu trop compliqué, et souhaite mettre un ordre dans ces relations. C’est l’accord cadre institutionnel, abstrait et général pour tous les accords existants et à venir. Une condition sine qua non. On est en 2010. Cela continue mais c’est de plus en plus difficile. J’ai comparé cela dans la NZZ à deux équipes, l’une qui voulait jouer au foot au milieu du terrain et une seconde qui s’adonnait à une épreuve de course d’orientation.
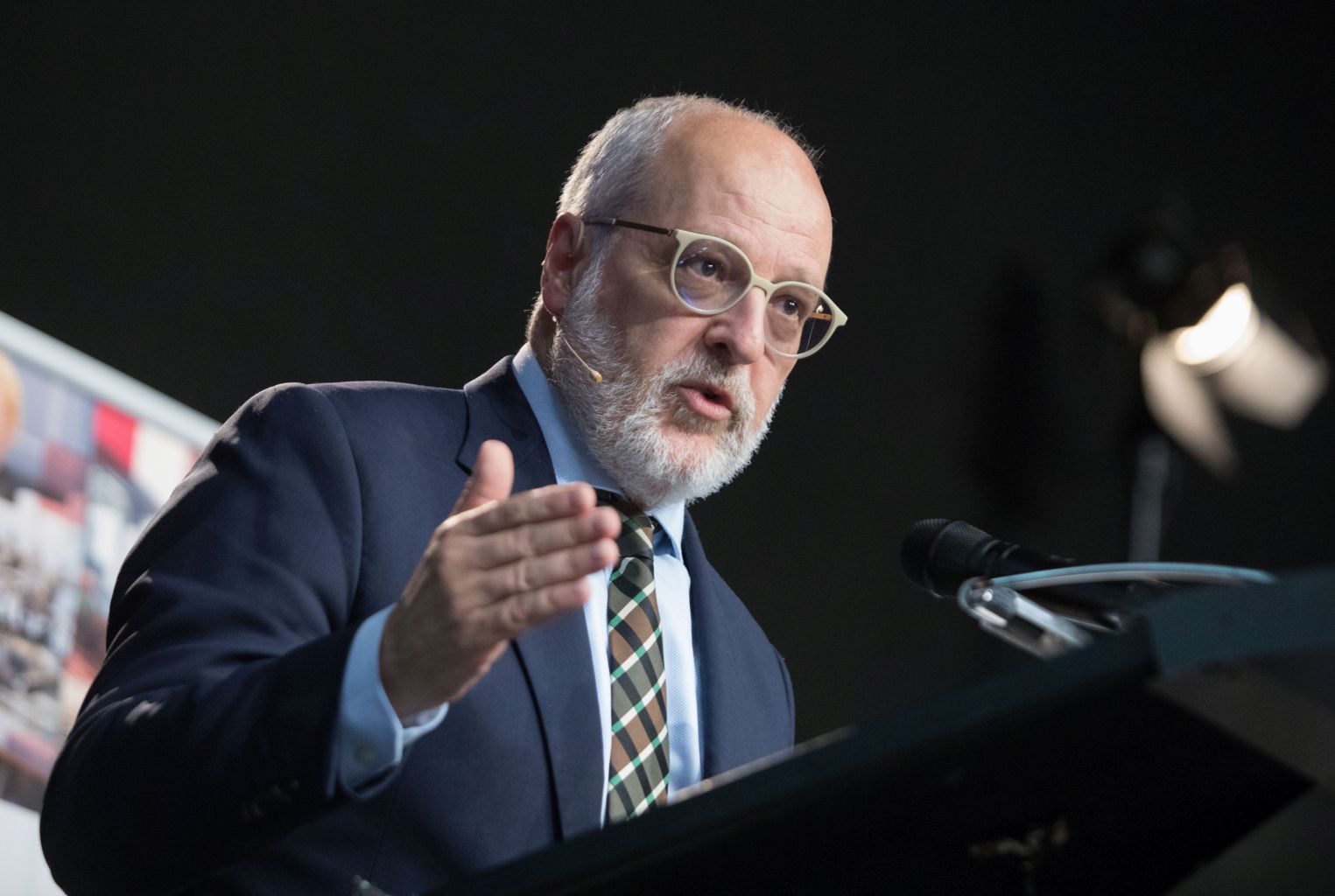
Le Conseil fédéral finit par tirer la prise. Il faut réinventer une approche. On propose à l’UE de négocier de nouveaux accords et de régler les questions institutionnelles dans la foulée. C’est ce que nous faisons depuis plus de deux ans. Nous avons engagé d’abord une phase exploratoire de sondages. Pour déterminer de quoi nous parlons et quelles sont les pistes d’atterrissage. Cela nous prend beaucoup d’énergie, c’est le «common understanding», sur la base duquel sont établis les mandats de négociation.
Le 18 mars, les négociations sont lancées. C’est ambitieux, mais nous souhaitons finir avant la fin de l’année. J’ai préparé ici un tableau résumant toutes les variantes possibles. On peut en faire moins, comme avec l’Angleterre, ou le Canada. Ou plus, comme l’adhésion. Le Conseil fédéral a analysé toutes ces variantes. Et il est arrivé à la conclusion que la voie bilatérale est le meilleur instrument. Mais pour cela, il faut parvenir à un accord avec l’UE. Donc on ne va ni vers le moins, ni vers le plus, mais vers une solidification de ce que nous avons. Cette solution permettrait d’aborder sereinement les trente à quarante prochaines années. Et tout ce débat européen qui pèse si lourd pourrait un peu s’évaporer.

Nous voulons défendre nos intérêts offensifs et défensifs. Sur la protection des salaires, actuellement la discussion se concentre sur la clause de sauvegarde (de 1999) que nous essayons d’améliorer. Nous avons tout un système de protection avec des principes, des exceptions et une clause de non-régression donc pas de détérioration possible ultérieure.
Pour l’immigration, des principes, des exceptions pour sauvegarder la situation de la libre-circulation et la mobilité liée au travail. Il y a quatorze tables de négociation. Je montre le slide pour rassurer sur le fait que nous savons ce que nous faisons. Nous négocions avec de la détermination et de la bonne foi.
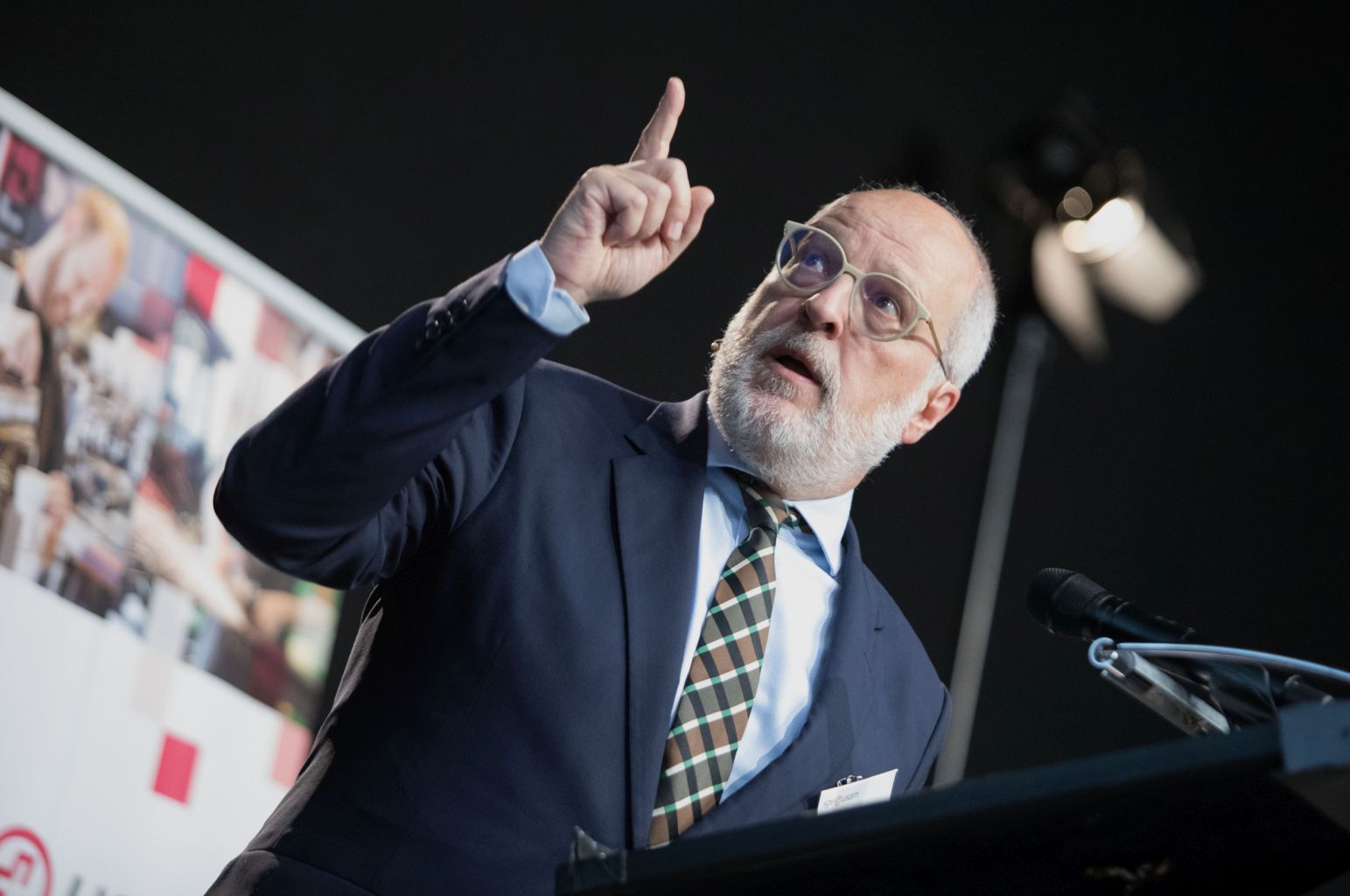
Il faudra construire un paquet de 50 lois en droit suisse pour que ces accords prennent effet. Cela se fera aux Chambres, et nous avons déjà commencé cet inventaire et toutes les discussions avec les partenaires sociaux. Tout cela est mené de front avec la négociation internationale. Il y a une concordance des temps, il faut avancer à la même vitesse en Suisse, pour pouvoir proposer aux Chambres un paquet unique.
Les questions à Alexandre Fasel
Le tribunal arbitral pose problème: est-il justifié dans la pratique?
Nous avançons bien sur ces aspects, et au final cela ne ressemblera pas à la thèse du juge étranger que certains brandissent. C’est dans notre intérêt d’avoir un instrument de règlement des différends. À l’avenir, on garde le comité mixte, puis à un tribunal arbitral qui tranche. C’est seulement en cas d’incertitude que l’on se tourne vers la cour européenne pour savoir ce que dit le droit européen. Puis, des mesures compensatoires peuvent être prises, et l’autre partie peut même demander d’examiner la proportionnalité de telles mesures compensatoires.
Les exigences des syndicats vous mettent sous pression?
Cela rend le dossier compliqué et complexe mais le paysage politique de l’UE est tout aussi compliqué, avec des intérêts divergents. Les deux parties se retrouvent dans des situations d’une complexité inouïe.
En cas d’échec?
Le Conseil fédéral a fait cette analyse. Si le peuple ne le suit pas, on verra. On peut repartir dans l’une des deux directions indiquées, plus ou moins de relations avec l’UE – si tant est que l’UE ait le temps et la volonté de le faire, ce dont je doute fortement. Aujourd’hui, nous disposons d’une fenêtre de tir parfaite. Face aux incertitudes et aux grands défis que l’UE va devoir affronter, mieux vaut profiter du temps à disposition, tant qu’elle en a, pour mettre en place une relation qui fonctionne et qui soit stable.
Fabio Regazzi: Il faut regarder la forêt mais les points de détails seront importants. Sur la réglementation concernant les frais. En Europe, ce sujet est déjà controversé. Que se passera-t-il sur ce dossier?
Alexandre Fasel: Il s’agit des frais concernant les travailleurs détachés. Nous voulions une exception. Certains pays souhaitaient que la base soit le pays où ces frais sont facturés, les autres que cette question des barèmes soit laissée ouverte à chaque pays. C’est cette position qui l’a emportée. Par conséquent, la Commission européenne ne pouvait pas nous donner une exception qui n’avait pas été donnée aux États membres. Le Conseil fédéral a tenu à trouver une solution. Les négociateurs sont en train d’en parler. À prendre en compte, une étude récente de l’UE montre que 16 des 27 pays appliquent le barème de l’État où les travaux sont effectués. Donc personne ne va aller au combat pour cela.
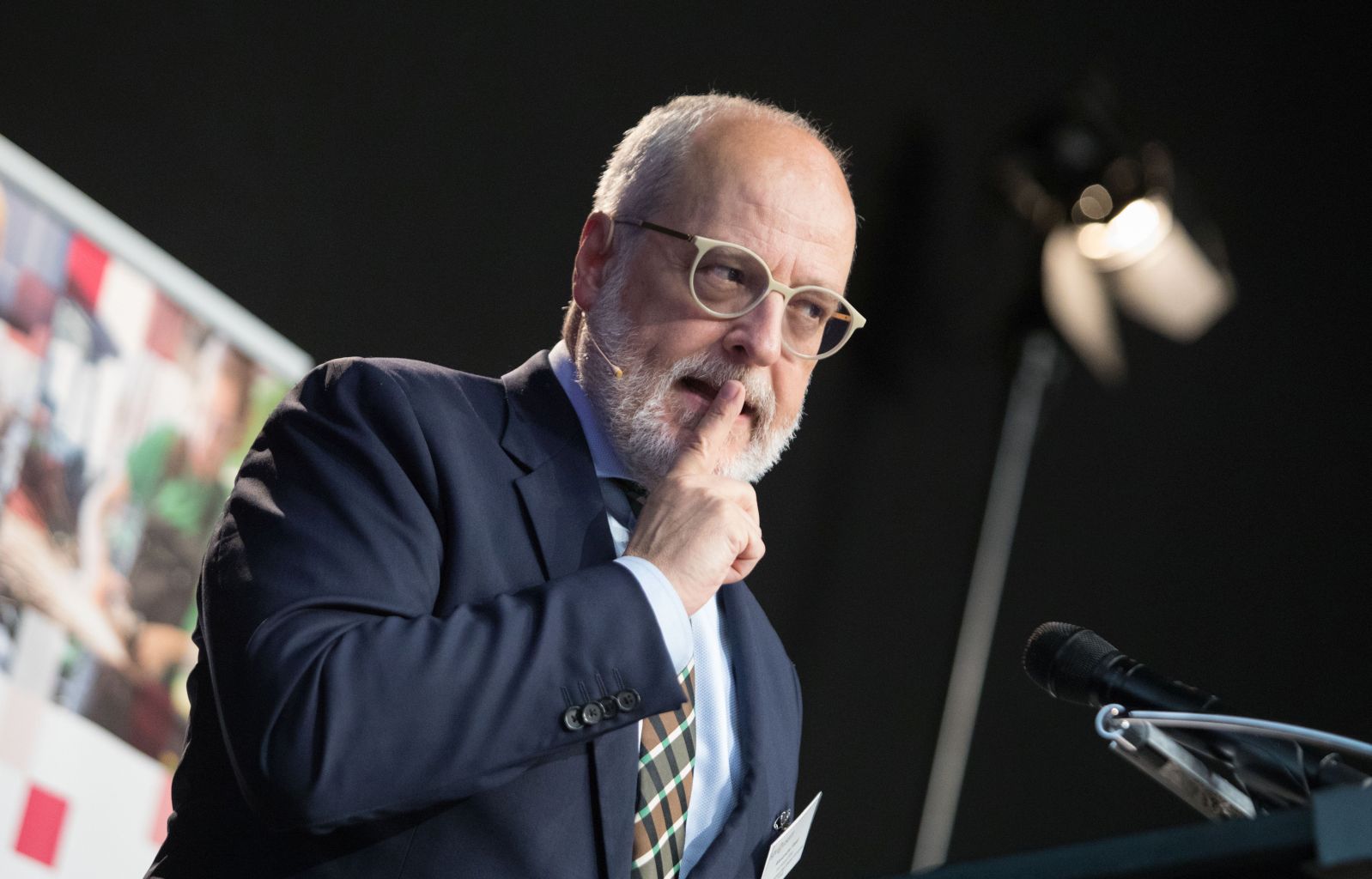
En cas de votation, un seul refus des 50 lois fera capoter le tout?
Non, la question est de savoir ce que comprendra le référendum soumis au vote. Pour l’instant, nous allons dans la direction d’un seul paquet. Les variantes sont de scinder en deux, un paquet avec tous les éléments institutionnels, accords d’accès au marché, la contribution pérenne, les programmes de coopération. Quitte à mettre les autres accords, santé, sécurité alimentaire, dans un autre accord. Mais pour l’instant, le Conseil fédéral opte pour l’idée d’un seul paquet.
Double majorité du peuple et des cantons?
C’est seulement en soumettant le projet aux Chambres, que le Conseil fédéral décidera si c’est un référendum obligatoire ou facultatif. La discussion débute sur ce sujet et on entend les deux solutions. Pour les négociateurs, le plus important est de rapporter ce qui correspond le plus à la vision du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral négocie, saisit les Chambres, explique, répond aux questions. Mais il ne fera pas campagne. C’est aux opérateurs politiques de le faire. Cela étant, les voix des adversaires sont nettement plus audibles que ceux des défenseurs de la cause. Espérons que cette tendance pourra être inversée.
Après un apéro pris à l’Hôtel Suisse, la soirée s’est déroulée au Café du Nord. Au programme des réjouissances, de bons vins valaisans, des spécialités de la région et une délicieuse raclette, raclée par deux anciens joueurs de hockey sur glace. De beaux échanges!






Reprise des travaux au Palladium de Champéry pour ces 57es Journées romandes des arts et métiers qui, en dépit d’une météo pluvieuse voire tempétueuse, se déroulent dans la bonne humeur et le partage.
Quels sont les principaux défis pour les PME dans l’arc lémanique?
Stéphanie Ruegsegger (SR), directrice du département de politique générale à la Fédération des entreprises romandes FER Genève: Le défi de la pénurie de main d’œuvre touche tous les types d’entreprises. Et le défi de l’employabilité représente aussi de mon point de vue un défi social.
Marcel Delasoie (MD): secrétaire général de l’Union valaisanne des arts et métiers: J’ajouterais le défi de l’innovation car nos entreprises à haute valeur ajoutée sont prospères. Et celui d’essayer de réduire les charges administratives qui pèsent sur nos PME. Chaque fois qu’on crée une loi au Parlement, on devrait charger l’administration d’en supprimer une autre.
Olivier Rau (OR), directeur du département politique du Centre patronal: Selon notre sondage, 40% des entreprises ont de plus en plus de peine à recruter. Certains indicateurs nous montrent que notre attractivité est moins bonne, le canton de Vaud n’est pas au mieux de sa forme avec les conditions-cadres actuelles. Nos infrastructures sont vieillissantes. Les délais s’allongent, la fiscalité s’avère lourde et on augmente même certains impôts.
Quelles pistes faut-il suivre?
SR: Nous avons à Genève une longue tradition de dialogue social. Notre conseil de l’employabilité a déjà eu un effet, celui de faire travailler les services de l’Etat de manière transversale. J’ajoute que la poursuite du dialogue avec l’UE est indispensable.

La réserve des travailleurs frontaliers est-elle menacée en cas d’échec des négociations?
SR: Cette réserve n’a jamais été contingentée. Si tel devait être le cas, nous serions dans une situation impossible. ?À Genève, un parti s’est créé sur le réflexe anti-frontaliers. Les frontaliers représentent un quart de notre marché du travail et nous ne pouvons pas nous en passer.
MD: En Valais, nous avons moins de frontaliers. En revanche, nous veillons à faciliter l’accès au marché et aux places de travail, notamment par les transports. Nous essayons de recruter d’abord au sein de notre jeunesse. L’enjeu se situe au niveau de l’apprentissage. Les professions redoublent d’actions pour attirer les jeunes, mais le panier global des candidats prêts à se lancer ne s’agrandit pas.

OR: Nous avons quatre fois plus de frontaliers qu’il y a vingt ans. Pour la pénurie, il faut combiner la formation continue et mobiliser les forces de travail que nous avons. Il faut de la flexibilité sur les temps partiels de la part des entreprises quand c’est possible. Soixante millions de francs sont collectés pour des milliers de places de crèche. Ce système doit être défendu.
MD: Notre Conseil d’État nous a sollicité sur ce chapitre, les communes ont mis les pieds contre le mur. Il faut redéfinir les tâches de l’accueil pour que les impôts que nous payons déjà servent à cela. L’exemple vaudois a été créé il y a longtemps et dans une période favorable, mais on voit que les gens paient toujours plus d’impôts et que nous entretenons des administrations pléthoriques.
Certaines études montrent que les jeunes veulent moins travailler et d’autres études mettent en évidence le fait que la productivité augmente. Comment s’adapter?
SR: Un coiffeur ne peut pas forcément travailler toujours plus vite. Une étude montre que le temps partiel n’atteint pas la productivité. Une fois qu’on aura assuré les accords bilatéraux III, on pourra adapter les conditions de travail aux exigences des nouvelles générations avec, pourquoi pas, des temps de travail plus amples, avec des pauses pour le sport, puis une reprise du travail. Les syndicats devront eux aussi se montrer plus ouverts à cette évolution.
OR: On doit faire une place pour les nouvelles générations et être à l’écoute de temps de travail qui ne sont plus forcément des horaires fixes de 8h à 17h.

MD: La dimension sacrée du travail, c’est terminé. Ce qui compte, aujourd’hui, c’est de s’épanouir. Quant à la productivité, elle augmente en raison de la mécanisation.
Les multinationales offrent de nombreux services aux employés. C’est un modèle?
SR: Oui, c’est un avantage dans de telles structures économiques. Les PME ne peuvent pas proposer toute cette gamme de services, mais elles disposent d’autres atouts. Et quand une entreprise peut se permettre d’offrir quelque chose en plus, en général elle le fait.

Les PME bénéficient-elles suffisamment des retombées des multinationales?
MD: Les retombées sont très importantes, en centaines de millions. Les PME ont tout à gagner à l’aboutissement rapide d’accords bilatéraux.
OR: Parfois il y a aussi un prix élevé à payer pour travailler avec les multinationales, comme des certifications coûteuses à obtenir avant de signer des contrats avec certaines d’entre elles. Il existe aussi une concurrence sur la main d’œuvre.
SR: Notre étude montre que 40% de la valeur ajoutée du canton provient des multinationales. Avec le départ d’une grande entreprise de la place comme Serono, un hôtel a perdu un million de chiffre d’affaires. Nous profitons donc de ce vivier international y compris des organisations internationales. Les impôts sur le bénéfice sont essentiellement payés par les grandes entreprises et notre pyramide fiscale est tellement pointue que c’en est finalement dangereux.
Quels sont les dommages que la surrèglementation cause aux PME?
OR: Au Centre patronal, nous avons procédé à un sondage sur la douleur causée par la règlementation, et demandé aux PME quelle était, sur une échelle de 1 à 10, la douleur ressentie. Le résultat est 6. En fait, cela varie avec chaque niveau, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, Confédération, cantons et communes, ou des partenaires sociaux. La sécurité au travail est douloureuse à cet égard. Le recours aux spécialistes également, vu les coûts que cela génère. Tout cela crée des montagnes de formulaires statistiques à remplir. Je m’arrête là, mais la liste est très longue.
Que faire concrètement?
OR: La loi sur l’allègement des règlementations, soutenue fortement par l’usam, est entrée en vigueur. Il faut donner une chance à ce texte pour lequel nous nous sommes beaucoup battus. On pourrait, comme piste de travail, offrir des conditions plus légères aux PME.
MD: Chaque fois qu’on engage ou qu’on remplace un fonctionnaire, on devrait se demander à quoi sert ce poste et s’il est vraiment utile. Un quart des entreprises qui engagent des apprentis se demandent si cela vaut la peine de continuer en raison de la surcharge de travail. Cela devrait nous faire réfléchir. On veut bien faire mais au niveau de l’entreprise, cela devient de plus en plus compliqué.
SR: Le bon sens devrait l’emporter. Différentes initiatives sont discutées. Le problème, ce sont les silos – le fait que les services de l’État travaillent en vase clos – au lieu de privilégier la transversalité. Un physio passe un quart de son temps à remplir des papiers. L’avantage des généralistes sur les spécialistes, c’est d’avoir une vue plus large. Et nous, les associations professionnelles, nous sommes là pour vous défendre!

Une question plus difficile. Qu’est-ce que vos organisations pourraient faire mieux?
MD: Peut-être de faire en sorte que les conditions de concurrence soient plus équitables. On se bat tous les jours, on entretient des contacts pour faire avancer les choses.
OR: Un défi, c’est le tissu économique plus individualisé. L’adhésion à une association ne va pas de soi. Cette appartenance à la corporation ne va pas de soi. Quel est le retour sur investissement par rapport à la cotisation? Nous essayons de proposer de nouveaux services et une orientation clients depuis plusieurs années.
SR: En vingt ans, la situation a changé et les gens se demandent pourquoi ils devraient payer pour une défense qui est générale. Nous devons démontrer tous les jours notre valeur ajoutée. Pendant la pandémie, nous sommes allés au front pour renseigner les entreprises. Nous entretenons un lien assez direct avec les autorités, c’est quelque chose de possible dans notre pays.
MD: On pourrait mieux se vendre auprès des entrepreneurs. Ils se disent que de toute façon, ce travail de défense de leurs intérêts se fera, qu’ils paient une cotisation ou non. Nos moyens sont modestes. En comparaison, un ouvrier syndiqué paie relativement vingt fois plus qu’une entreprise pour sa cotisation. C’est ce qui permet aux syndicats de réaliser des campagnes.
Comment se préparer au mieux pour retrouver cette attractivité?
OR: Parmi les vrais grands défis, on trouve la démographie, le vieillissement de la population. De l’autre, on dispose de cette fameuse innovation suisse. On se rend compte qu’en matière d’attractivité, ces incitatifs fiscaux sont de moins en moins déterminants. On entend des choses nouvelles à l’étranger, certains paient des loyers en cas d’installation, etc. Une réflexion globale doit être menée.
SR: Allons regarder ce qui se fait ailleurs! Cela se joue aussi dans l’éducation, dans la formation de base. Incitons les jeunes filles à s’intéresser aux métiers innovants!
MD: J’ai eu l’occasion de visiter une entreprise pas très loin d’ici: AISA, fabrique des machines pour produire des tubes de dentifrice dans le monde entier. Ces gens fabriquent leurs machines avec passion.
Questions de la salle: Comment toucher les nouvelles générations? Faut-il être sur TikTok?
OR: En organisant des événements qui les intéressent. Mais pas forcément sur TikTok.
SR: Les entrepreneurs de demain sont sur TikTok. Et oui, il y a des événements qui permettent de changer notre image.
Intervention de Steve Delasoie (GastroValais): Nous savons sur quelle partie nous devons travailler pour s’adresser aux jeunes. Par exemple, nous avons créé un manga. Je dirais que de manière générale, il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Et montrer comment le métier va évoluer et comment il a déjà évolué. Une nouvelle génération partira à la retraite et nous devons la séduire, donner du sens à ce que nous faisons.
Antoine Dussart (AD), directeur des opérations internationales du Groupe Partnaire: Nous avons quelques pistes de réflexion. Nous faisons travailler 13’000 intérimaires en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Nous créons des passerelles et améliorons l’employabilité. On essaie de mettre en condition nos équipes qui sont autonomes. C’est comme ça que nous améliorons la productivité.
Eric Ziehli (EZ), directeur développement stratégique Suisse de Helvetic Emploi SA sous la bannière de Groupe Partnaire: Nous avons créé notre entreprise dans divers secteurs puis nous avons rejoint le Groupe Partnaire, avec lequel nous avons trouvé des affinités. La confiance, la simplicité, l’enthousiasme, la positivité: ce sont pour nous plus que des mots, mais des valeurs familiales.
Comment avez-vous vu arriver cette pénurie?
EZ: C’est une cause démographique qui l’explique, à laquelle s’ajoute une autre composante, une conjoncture en pleine croissance. Il faut le dire: c’est aussi un peu un problème de pays riche et on est sur un nuage. Dans le cas de la Suisse s’ajoute le fait que c’est une économie très résiliente.
AD: Le rapport au travail a changé et s’est accéléré avec la pandémie. Les candidats ont des aspirations, des attentes sur le salaire, sur l’équilibre de vie, sur le respect des autres sur le lieu de travail. Mais toutes ces choses-là, on peut aussi les faire dans une PME. Il faut expliquer aux candidats quelles sont les valeurs de l’entreprise, son style de management, vers quoi on va, etc. Si on n’explique pas tout cela, la question du salaire ne va pas suffire. Le candidat doit s’inscrire dans un projet auquel il peut s’identifier. J’aimerais ajouter qu’il y a peut-être une cartographie de l’emploi à revoir en Suisse. Ne manque-t-il pas des filières courtes et très opérationnelles?

EZ: Une femme de ménage peut devenir facilement auxiliaire de santé via des cours de la Croix-Rouge. Un manœuvre de chantier peut devenir chauffeur de bus. Ce sont des initiatives privées et il faut que l’État nous aide. Ces formations sont en effet payantes.
AD: On peut trouver des accords entre entreprises, comme nous l’avons fait à Bordeaux pour une dizaine de peintres. Autre exemple, avec des conducteurs routiers femmes pour du longue distance. On l’a fait avec plusieurs entreprises. Nous avons dressé une liste de métiers «pénuriques» en Suisse, mais nous avons eu très peu de candidats. Ce n’était pas suffisant. Il fallait pouvoir les envoyer sur place pour leur montrer les choses en détail, qu’ils aient le feeling. En revanche, nous avons obtenu une dizaine de recrutements en faisant du sur-mesure. Le plus important, c’est de passer du temps à expliquer. Culturellement, c’est ce qui a changé en vingt ans.

Qu’est-ce que la Suisse pourrait faire?
EZ: Un problème, c’est qu’en Suisse, on ne forme pas des gens dont on a besoin, qui peuvent apporter un plus sur une production. Il faudrait des formations simples pour les opérateurs.

Les seniors constituent-ils un vivier?
EZ: Entre 55 ans et 65 ans, on a plein de gens qui ne trouvent pas de travail. Il faut que les pouvoirs publics valorisent cela.
AD: Les apprentis ne sont pas bien formés lorsqu’il n’y a pas de seniors expérimentés dans une entreprise.
10h30-11h00 Pause-café
Julien Morand. Les eaux minérales, les vins, les alcools sont sous pression. Il y a un véritable enjeu. Essayez de jouer régional, national et soutenez nos produits!
Timothy Nussbaumer, chef suppléant du secteur Croissance et politique de la concurrence, Secrétariat d’État à l’économie (SECO): Je vais prendre d’abord un peu de recul et aborder les défis qui nous attendent. Quelle a été l’évolution récente de l’économie suisse? Après dix ans sans récession, ce fut le coup d’arrêt à cause de la pandémie, comme le montre l’évolution du PIB par rapport à l’économie mondiale.
L’effondrement a été moindre en Suisse. La résilience a profité de plusieurs facteurs. Une industrie chimie et pharmaceutique, moins de tourisme que dans certains pays. Puis la guerre en Ukraine a entraîné une crise énergétique et une hausse de prix de l’énergie. L’inflation a aussi épargné notre pays en comparaison internationale (+2,8%). À prendre en compte également, le fait que l’intensité énergétique de l’économie et de l’industrie manufacturière est nettement inférieure en Suisse par rapport à l’étranger. Le PIB est le plus élevé en Suisse, au Luxembourg et en Norvège. L’évolution du PIB par habitant était encore le plus élevé en 2001 et 2010.
Une hausse du PIB par habitant peut se faire soit en travaillant plus, soit en augmentant la productivité. Entre 2011 et 2022, cette croissance du PIB est encore supérieure à la moyenne. C’est aussi le cas durant les deux crises. En revanche, sur cette même période, la contribution des heures de travail par habitant a diminué, son impact a été négatif.
Que s’est-il passé? C’est la productivité qui s’est améliorée. Qu’est-ce que cela explique? On pourrait se dire que les Suisses travaillent moins. C’est vrai que les temps partiels ont bien augmenté. Serions-nous devenus paresseux? Ce n’est pas si simple. Si les hommes ont fait plus de temps partiel, les femmes ont augmenté leur participation à l’économie.

Cette tendance existe depuis plusieurs années et risque de se prolonger. En revanche, est-ce que l’effet net sera encore positif sur le PIB par habitant. Le facteur décisif, c’est le changement démocratique. La population active a augmenté en raison d’une forte immigration entre 2011 et 2016 mais la croissance de la population active totale sera négative selon le scénario de référence de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Cet effet des baby-boomers va diminuer toutefois dès 2030. Entre 2022 et 2030, le taux de croissance annuel du PIB devrait diminuer de 0,3% en Suisse. Il sera donc très important de soulager les PME du point de vue des coûts.
Et dans le calendrier politique? La réforme AVS 21, la suppression des droits de douane industriels ont passé. En revanche, la suppression du droit de timbre d’émission et la réforme de l’impôt anticipé ont échoué. Et il y a ce qui doit être mis en œuvre: l’accès au marché de l’UE, les accords de libre-échange (Inde, Chine, Mercosur) et la réduction de la charge administrative.
Dans les éléments à prendre en compte, le développement de la cyberadministration, les nouveaux instruments d’encouragement à la décarbonisation de l’économie, la facilitation de l’admission de spécialistes formés en Suisse – qui pourraient rester en Suisse après leurs études.
Nous voulons augmenter les incitations au travail et corriger les finances publiques en examinant toutes les tâches et subventions pour favoriser les économies. Comme vous le voyez, l’agenda du Conseil fédéral est bien rempli!

Quel sera l’impact de l’IA générative sur l’économie, son influence sur la productivité et sur l’emploi?
Nous n’avons pas fait une étude mais nous collaborons avec l’OCDE qui a étudié la question. Le fait est que, depuis les années 1990, nous peinons à voir quel est l’impact réel sur l’économie, mais il semble qu’il reste mesuré. On utilise plus souvent DeepL, mais les traducteurs consacrent plus de temps au rédactionnel. Donc au final, nous misons sur la qualité. C’est ce genre de choses qui risque de changer avec l’arrivée de l’IA.
Questions de la salle – Quel sens donner à la faible intensité énergétique en Suisse?
On voit que la même industrie consomme moins qu’à l’étranger. La réglementation environnementale est plus sévère et les prix de l’énergie plus élevés.
Ces deux journées auront été riches. Qui sème l’union récolte des succès, comme on dit à l’usam. Il est crucial de reconnaître la force de l’économie romande – et celle du Tessin aussi, ajouterais-je. Les éclairages que nous avons entendus sur l’UE ont été précieux. Les enjeux sont complexes. Sans parler d’idéal, pensons aux équilibres qui pourront être trouvés. Car en fin de compte, pour faire passer le projet, nous devrons collectivement nous montrer capables de trouver une majorité. L’usam se prononcera une fois que le résultat des négociations sera connu.

Des incertitudes, il y en a, des potentiels aussi. Mais les PME ne doivent pas être oubliées. La pénurie de main d’œuvre est cruciale, et les défis liés à la productivité le sont tout autant. Mais nous devons aussi garder en tête les projets d’infrastructures – et en particulier l’avenir des routes nationales. Il faudra voter oui lors de la votation cet automne. Merci à tous pour votre participation, et à l’année prochaine – les 26 et 27 juin 2025. Voilà, c’est fini!
Notes prises en situation par François Othenin-Girard, les jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024 / Journal des arts et métiers (JAM). Relectures et corrections: Laura Di Lullo.